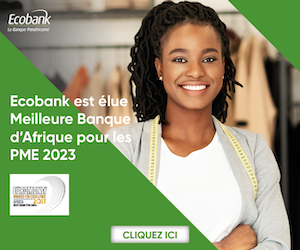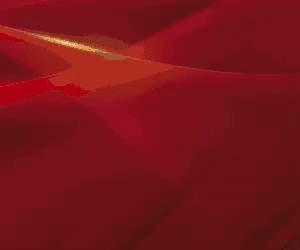Opinion: « Qu’est-ce qui ne va pas aux Etats-Unis ? »

« Qu’est-ce qui ne va pas au Kansas ? » (What’s the Matter with Kansas ?) avait lancé en 1896 le journaliste William Allen White. « Qu’est-ce qui ne va pas aux Etats-Unis ? », est-on tenté de se demander aujourd’hui. Comment expliquer qu’un businessman qui multiplie les outrances et insulte les Latinos et les femmes (deux électorats que son parti se doit de séduire) et qu’un sénateur se proclamant socialiste, un label jusqu’ici fatal dans le pays phare du capitalisme, rassemblent les foules les plus enthousiastes et fassent trembler l’establishment ? Sinon par l’anxiété suscitée par les mutations des Etats-Unis au cours des dernières décennies et par la colère qu’elle a fini par instiller envers un personnel politique incapable de la dissiper.
Depuis le Vietnam et le premier « choc » pétrolier, en effet, les grandes certitudes des Etats-Unis n’ont cessé de se voir ébranlées. Les certitudes économiques, tout d’abord, tandis que, sous l’impact de la robotisation, des délocalisations et de la financiarisation, le « rêve » américain se désenchantait : les revenus ont stagné, la mobilité sociale s’est rétractée et les inégalités se sont envolées. Les certitudes identitaires ensuite, tandis que les classes moyennes blanches se sentaient prises en étau entre un afflux de population immigrée (16,5 % des salariés sont nés à l’étranger) et des élites multiculturelles de plus en plus indifférentes à leurs intérêts. Les certitudes géopolitiques enfin tandis que le 11 septembre, les déboires en Irak et en Afghanistan et l’ascension de la Chine suggéraient que si leur pays restait toujours « le premier », le « Siècle américain » appartenait au passé.
En macérant au fil des années, ces frustrations ont engendré une polarisation partisane qui a largement paralysé le jeu politique et rendu l’Etat encore plus impuissant à répondre aux défis. Se sentant exclus et ignorés, un nombre croissant d’Américains s’en sont désintéressés tandis que les lobbies et l’argent s’engouffraient dans le vide ainsi créé. C’est cette dérive vers un système toujours plus ploutocratique qui inspire aujourd’hui ces deux insurrections populistes. Chacune d’entre elles n’en est pas moins spécifique.
La contestation, au sein du parti démocrate, représente la version « soft » – essentiellement socio-économique et inclusive – du populisme. Elle répond à l’orientation prise par le parti dans les années 1990. L’accent mis, sous Bill Clinton, sur l’ouverture des frontières (l’ALENA, l’Uruguay Round, l’entrée de la Chine dans l’OMC) et sur l’expansion de la finance avait été tant bien que mal toléré par une base qui le réprouvait dans la mesure où 23 millions d’emplois avaient alors été créés. Mais la « Grande Récession » et les dénonciations d’Occupy Wall Street ont souligné à quel point le jeu était « truqué » et en ont rappelé les dangers : à commencer par le formidable creusement des inégalités entre les « 1 % » des Américains les plus aisés et la grande majorité. Auprès d’une partie des militants démocrates, cette évolution a renforcé le handicap que, pour Hillary Clinton, ses liens avec Wall Street représentaient tout en minimisant celui que le « socialisme » de Bernie Sanders constituait : fin 2011 si, dans l’ensemble de la population, le socialisme continuait de provoquer des réactions négatives, 59 % des démocrates « progressistes » et presque 50 % des jeunes Américains en avaient une vision positive.
Chez les républicains, la rébellion est ancienne. Elle s’inscrit dans une version « hard », c’est-à-dire identitaire et nativiste, du populisme, mue autant par le ressentiment face à l’évolution culturelle (la révolution sexuelle et le modernisme) et démographique (la perspective de voir un jour les Blancs minoritaires en Amérique) que par les frustrations économiques. Depuis le vote en 1964 et 1965 des grandes lois sur les droits civiques et, plus encore, sa conversion au néolibéralisme dans la seconde moitié des années 1970, la stratégie du parti a, en effet, largement reposé sur la conquête du Sud. Pour mobiliser les troupes susceptibles de lui assurer une majorité (en particulier les Evangéliques sudistes mais aussi les « cols-bleus » du Midwest), les stratèges conservateurs ont très vite embrassé une rhétorique antimoderniste, subliminalement raciste et, par la suite, nativiste. Cette rhétorique a progressivement pris le pas sur leur projet politique : impuissants à répondre aux attentes de leurs militants, ils ont choisi, pour les fidéliser, de leur instiller une haine des démocrates accusés de faire preuve de « faiblesse » à l’extérieur, d’encourager la décadence des mœurs et de conduire, via l’étatisme, le pays à la ruine. La dénonciation du tout-Etat (Big Government) a été au cœur de ce combat : elle avait pour mérite de répondre à l’attente des milieux économiques (dérégulation, baisse de la fiscalité pour les plus riches et les grandes sociétés, ouverture des marchés) tout en détournant la colère des classes moyennes blanches que ces politiques lésaient contre les programmes sociaux accusés d’enrichir les minorités.
Pour mesmériser des électeurs désemparés de voir malgré tout leur statut continuer à se dégrader, le mouvement conservateur a créé ses propres vidéosphère (avec Fox News pour pilier) et blogosphère chargées de diffuser sa vision biaisée de la science et des faits. Ce sont elles qui, lorsque la crise de 2007-2008 a menacé de le discréditer, ont fait le lit de la Tea Party : en répandant l’idée que le problème était moins la cupidité de Wall Street ou la corruption et le dysfonctionnement du Congrès que le tout-Etat, l’immigration et la présence d’un Africain-Américain à la tête du pays.
En 2010, les républicains se sont ainsi assuré un éclatant succès, tant au sein des Etats qu’au Congrès. Mais le coup de fouet en retour n’a pas tardé. La course à l’extrémisme s’en est, en effet, trouvée accélérée : aujourd’hui, pour être adoubés, les candidats du parti sont conduits à adopter des positions (sur les droits des femmes, les armes à feu) minoritaires au sein du pays et à tenir sur l’immigration un discours ravageur pour la stratégie nationale du parti. De plus, ces postures se révélant fatalement irréalistes (comme celle sur l’abrogation de l’Obamacare), la base s’est toujours plus sentie trompée : à l’été 2015, 62 % des électeurs républicains se disaient trahis par les élus du parti. Il a, du coup, été facile à Trump de déborder ses rivaux « modérés » sur le terrain qu’ils avaient labouré : en multipliant les propos outranciers (sur l’immigration en particulier), mais aussi en dénonçant l’ouverture des marchés, il a séduit des salariés blancs frustrés et exaspérés.
Ces insurrections vont-elles durer ? Presque toujours, les grands partis finissent par désigner un candidat sinon centriste, du moins assez consensuel pour préserver leur chance de l’emporter. Mais si les jeux sont loin d’être faits, rien ne va plus dans une Amérique en colère et désabusée.
Pierre Mélandri est historien et professeur des universités émérite à l’Institut d’études politiques de Paris.
Source: LeMonde.fr
Nous vous proposons aussi
TAGS
étiquettes: Monde