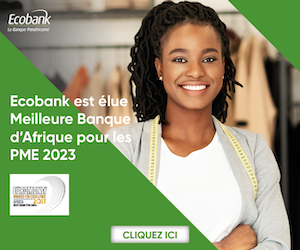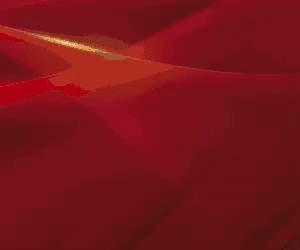Pour un Oui ou pour un Non : Du discours à la pédagogie de la violence

Au moment où j’écrivais la dernière fois sur le thème de la crise en Guinée, je n’étais pas sûre que les élections auraient lieu : Je me disais que la sagesse et le pragmatisme prendraient le dessus sur les ambitions personnelles. Je m’étais aussi dit que des leaders imprégnés des normes morales internationales suspendraient toute élection pour ne pas exposer les populations à la pandémie du Coronavirus. Finalement, je misais sur la foi constitutionaliste du chef de l’état qui, en tant que juriste, devrait savoir et être attaché au principe constitutionnel moderne qui fait de la protection du corps social et du citoyen la première obligation de l’Etat.
J’avais émis l’opinion que la crise actuelle présentait deux aspects positifs qui donnent espoir : 1) j’ai été surtout impressionné par l’insistance de l’opposition quant à la nécessité d’utiliser un fichier électoral crédible ; 2) la conversion d’une partie importante de la population, du moins dans le langage, à l’idée que le pouvoir souverain et les droits fondamentaux doivent être garantis par une constitution. Ces deux développements suggèrent une tendance vers un changement dans la culture politique du pays que nous devons tous saluer. Il faut aussi reconnaitre l’effort fourni par le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) pour cette avancée politique. Toutefois, il serait souhaitable que sa démarche aille au-delà de la suprématie accordée à la constitution dans la hiérarchie des normes juridiques, et de la loi en particulier. Pour les raisons ci-dessus, je reste optimiste quant à l’évolution éventuelle de la culture politique en Guinée vers des normes universelles.
Par contre, le chemin à parcourir reste toujours long. En rétrospective, je dois reconnaitre que je m’étais trompé sur la détermination de l’autorité à organiser les élections. A l’issue de ces élections, les partisans du pouvoir ont proclamé que le président avait gagné son pari. Mais à quel prix ? Le premier prix serait l’éventualité de la propagation du coronavirus de la capitale, où il était confiné avant les élections, au reste du pays. Sur ce sujet, nous espérerons que le virus n’a pas été propagé pendant les déplacements des officiels, monitors, et électeurs ; ou pendant que ces individus et collectivités effectuaient entre eux les transactions liées auxdites élections. Je souhaite en toute sincérité que ma peur par rapport au risque de propagation du coronavirus était exagérée et que les élections n’ont présenté aucun risque de santé publique. Nous le saurons dans les semaines à venir.
Toutefois, comme on le voit à Nzérékoré, le pire est arrivé, au niveau de l’usage de la violence comme moyen de communication de la volonté du pouvoir et de ses partisans. Le forcing du pouvoir, qui a consisté à l’organisation des élections malgré une opposition majoritaire incontestable, a été reçu comme une leçon qui a été ensuite relayée et amplifiée par des partisans du ‘oui’. Cette leçon du forcing a deux aspects : le premier aspect était de ne rien concéder à l’opposition sur la modalité de la tenue du referendum et sur la mise en norme du fichier électoral. Le deuxième aspect était de surmonter tout obstacle à l’obtention du résultat escompté, c’est-à-dire l’adoption de la constitution. Dans la pratique, les partisans du ‘oui’ devraient non seulement rassembler les votes qui leur étaient favorables mais ils devraient aussi donner l’impression que l’opposition au referendum était négligeable. Dans un contexte ordinaire, la stratégie relève d’un jeu politique normal. Cependant, dans le contexte du forcing électoral rien n’a été ordinaire, la pédagogie, ou méthode par laquelle la leçon a été passée n’était pas ordinaire non plus. Cette pédagogie est partie de discours menaçants du sommet de l’Etat suivi d’actes répressifs contre l’opposition par les forces de l’ordre. Il n’était alors pas étonnant, dans la logique de cette pédagogique, que le Préfet de N’Zérékoré, par exemple, profère des menaces de répression sanglante contre ceux qui étaient perçus comme une entrave au projet constitutionnel qui apparaissait, les jours passant, comme étant un projet d’Etat non inclusif.
Je partage ici l’avis du Dr. Lansana Faya Millimouno du Bloc Libéral qui demande à nos populations (sans exclusion) de ne pas céder à la tentation de la rupture intercommunautaire que nous propose le pouvoir et « ses acolytes ». La région forestière partage avec les autres régions de la Guinée un fort brassage et une mixité que nous nous devons de protéger. Pour reprendre les termes de Lansana Faya Millimouno, depuis des siècles, cette région de la Guinée abrite Kpèlès, Lomas, Manons, Konons, Kissis, qui sont à majorité chrétiens qui y côtoient Malinkés, Konians (et maintenant Peulhs and Sousous) qui sont à majorité musulmans. A qui profiterait dans ce contexte donc la mise à feu d’Eglises à Nzérékoré si non ceux qui veulent la rupture communautaire ? Il s’agit justement d’une minorité pour laquelle le vote ethnique ou communautaire est le geste civique suprême. Pis, ce n’est pas seulement le vote communautaire qui est prescrit mais le vote pour l’ethnie à laquelle elle appartient. Il ne s’agit donc plus de voter mais de démontrer sa fidélité envers une ethnie en particulier. Tout autre choix est considéré comme traitrise. Dans ce contexte, l’unité nationale et la mixité intercommunale sont plutôt un obstacle à leur projet politique qu’un atout collectif.
Malgré ce juste constat, il faut aller plus loin dans l’analyse pour entrevoir une solution permanente de sortie de crise. La violence que nous vivons est un symptôme d’une crise institutionnelle, morale, et spirituelle plus profonde. L’autoritarisme communautaire n’est que le moyen par lequel la crise s’implante. Ce que nous constatons en Guinée se manifeste aussi ailleurs, de l’Inde à Myanmar, de la Hongrie au Venezuela, et ailleurs en Afrique où le principe majoritaire ou pluraliste de la démocratie est mis au service de projets anti-libéraux et anti-républicains. Ici je parle d’un mal général qui a ses particularités selon les cultures et mœurs politiques et contextes historiques. A Myanmar, par exemple, ce sont les musulmans de la Province de Rankine qui sont pris pour cible. Dans cette province, depuis l’avènement de le junte militaire et la transition démocratique, le citoyen musulman birman est perçu comme un ennemi du « peuple ». Selon le persécutant, le musulman à Rankine est ou susceptible d’infiltration étrangère ou représente un danger pour l’identité bouddhiste du pays. Plus proche de nous au Rwanda, le citoyen dit Tutsi était pareillement la cible d’invectives avant le génocide de 1994 simplement parce que la constitution du projet national ne s’accommodait pas à l’idée d’une démocratie non-ethnicisée. Bref, chaque cas est unique à un certain égard et je ne confonds guère le cas guinéen aux premiers. Mais les discours et pratiques qui ont conduits aux évènements de Nzérékoré doivent inquiéter les avertis parce qu’il s’agit d’actes communautaires non-encadrés par des structures formelles. De tels actes peuvent basculer aisément dans l’extrême comme on l’a vu au Liberia voisin, entre les Khrans—de l’ethnie de Samuel Doe, d’une part, et les Gios et Manons d’autre part, il y a quelques années.
J’ai mentionné les cas du Myanmar, du Rwanda et du Liberia pour deux raisons. La première est l’intérêt qu’y ont trouvé les institutions internationales et les défenseurs du droit humanitaire. Je m’intéresse aussi à ce que ces cas étrangers ont d’universel et qui se rapprochent donc au cas guinéen : l’autorisation ou une attitude coupable d’hommes politiques à la tête de l’état ; l’apparence d’un projet communautaire comme projet d’état ; une opposition à la mixité intercommunautaire ; une intolérance envers tous projets inclusifs ; et, finalement, le mépris de la personne de l’autre qui apparait ainsi comme une nécessité constitutionnelle et une urgence politique pour les partisans de la rupture. Ce mépris de l’autre est accompagné par à un déni de droit de l’autre au respect, à la dignité et, comme on le voit aujourd’hui, à l’existence même.
En somme, nous faisons face à un double mal constitutionnel et institutionnel qui sont liés à des carences morales, institutionnelles, et culturelles qu’il faut aborder sans mépris ou ressentiments envers l’autre. Mais il ne faut pas se leurrer non plus. Si notre but demeure la coexistence citoyenne et la tolérance de l’autre, ils restent des projets d’Etat qui ne s’accordent pas avec l’unité nationale, la quiétude sociale, et la paix intercommunautaire. Nous aurons le dessus seulement si nous refusons d’emprunter de tirer les leçons de la dynamique politique régnante. Nous devons rejeter la méthode des actuels gouvernants mais surtout leur pédagogie qu’ils distillent dans le langage, les mots d’ordre, et les instructions qu’ils transmettent à leurs partisans de la violence intercommunautaire. Je conclu donc en disant que je m’associe à toutes les propositions pacifiques de sortie de crise. Je partage aussi l’idée d’enregistrer méthodiquement les évènements en cours, les incidents quotidiens, les noms des victimes, et les identités de protagonistes, etc. Notre mémoire collective seule nous guidera dans la réconciliation. Elle devrait servir d’index d’actes à ne jamais infliger à l’autre.
Siba N'Zatioula Grovogui
Professeur, droit international, relations internationales, et sciences politiques
niepoulon@gmail.com
Nous vous proposons aussi
TAGS
étiquettes: A vous la paroles, Libre Opinion